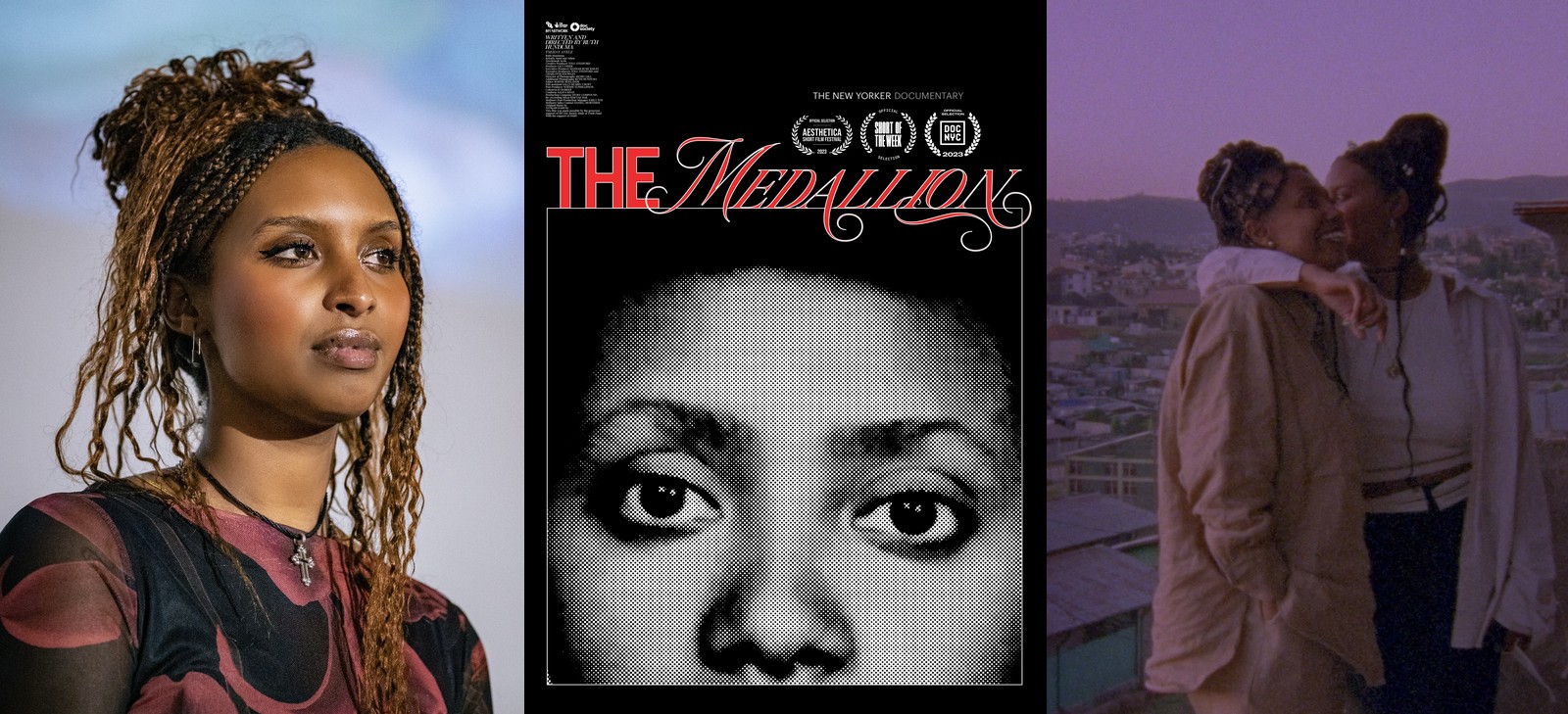Féroce et galvanisante, la fable féministe venue de Macédoine du Nord Dieu existe, son nom est Petrunya, a fait sensation dans la compétition de la dernière Berlinale. Comme sa glorieuse héroïne, la réalisatrice Teona Strugar Mitevska n’a pas la langue dans sa poche, et tant mieux. Avec un humour vache, elle nous parle de sa place dans une industrie du cinéma, un pays très religieux, et une société patriarcale où – comme il est dit dans le film – « Rien que d’être une femme c’est déjà briser les règles ».
—
A l’origine de votre film, il y a des événements qui ont réellement eu lieu. Pouvez-vous revenir dessus?
Ça s’est passé il y a trois ans, dans le village de Štip, là même où nous avons tourné le film. Une femme s’est bel et bien incrustée dans ce rituel réservé aux hommes, elle a plongé dans la rivière, elle a récupéré la croix et le village est devenu fou. Tout le monde était outré qu’une femme ait osé participé à ce rituel religieux, tous les journaux en ont parlé. Elle a même été interviewée à la télévision nationale où elle a déclaré en toute simplicité : « Si j’ai pu attraper cette croix, c’est simplement que je suis une meilleure nageuse que tous ces hommes. Je mérite ma récompense ». Quelle audace. Quelle claque. Ma sœur, qui est productrice du film et qui joue par ailleurs le rôle de la journaliste, a entendu parler de cette histoire la première, et elle m’a tout de suite convaincue qu’il fallait en faire un film.
A quoi sert le cinéma? On raconte une histoire pour transmettre quelque chose à tout prix. Or on ne trouve pas tous les jours des histoires qui traduisent aussi bien le monde dans lequel on vit. Cette histoire, c’est un bijou. Tout ce que je voulais dire sur le monde d’aujourd’hui se trouve dans cette incroyable anecdote : la vie des femmes dans les Balkans, les relations entre l’Église et l’état, le népotisme, la corruption, et tout ce qui fait que les femmes sont encore des citoyennes de seconde zone un peu partout – pas seulement en Macédoine du Nord. On ne peut pas dire que la justice et l’équité règnent sur la planète, même pas ici en France.

Avec un point de départ aussi polémique, était-ce facile de convaincre des Macédoniens de participer à ce film et de le financer ?
Vous savez quoi ? C’est mon cinquième film et c’est celui que j’ai eu le plus de facilité à financer. Mon pays est très politisé, mais on n’a pour ainsi dire que deux partis politiques, très opposés, et ce n’est pas toujours facile d’essayer d’exprimer quelque chose de différent ou nuancé. Il faut se battre, et ça tombe bien, parce que j’ai toujours pensé qu’il y avait des choses plus importantes que de chercher à plaire à ceux qui m’entourent. En Macédoine, j’ai parfois l’impression que l’industrie du cinéma ne sait pas quoi faire de moi. Pour mes films précédents, les premiers à me donner du financement étaient les Français, les Slovènes ou les Belges. Ce n’est pas quelque chose qu’on entend tous les jours mais j’ai envie de dire merci à l’Union Européenne (rires).
Il se trouve qu’il y a trois ans, un nouveau système de financement a été mis en place, copié sur celui de je ne sais plus quel pays. Pour faire financer un scénario, il faut désormais le soumettre de façon anonyme, sans mention du sexe ou du genre de la personne qui l’a écrit. Comme par hasard, cette fois-ci, j’ai obtenu mon financement comme ça (elle claque des doigts, ndlr). Les membres du comité étaient furieux de découvrir que c’était moi et ma sœur qui étions derrière ce scénario qui leur avait plu, mais ils ne pouvaient plus rien faire puisqu’on avait obtenu le nombre maximum de points. Enfin de la démocratie, de l’équité et de la justice pour tous.

Pour autant, vous n’avez pas obtenu l’autorisation de tourner les scènes prévues à l’intérieur de l’église du village, c’est bien cela?
On tenait à dialoguer avec le personnel de l’église en question, puisqu’ils ont vécu les vrais événements. On leur a envoyé le scénario, et j’aime autant vous dire qu’on a encadré la réponse qu’ils nous ont faite, elle est encore affichée dans notre bureau. Ils nous ont renvoyé le scénario en nous disant : « Nous ne voulons rien avoir à faire avec votre film. Nous connaissons Dieu et nous ne pouvons être d’accord avec votre titre, car Dieu est un homme » (le titre original du film précise en effet « Dieu existe, ELLE s’appelle Petrunya », ndlr).
Nous sommes donc parties à l’autre bout du pays pour tourner dans une autre église, mais même là on a été obligées d’agir en cachette. On avait bien ri avec leur réponse mais on avait quand même très peur de se faire prendre. Au final on s’en est sorties en faisant comme les femmes ont toujours fait : en douce, en prenant la tangente.
En revanche le reste du film a bel et bien été tourné dans le village d’origine. Je ne sais pas si notre présence là-bas a changé quoi que ce soit, ou bien s’il suffisait de laisser passer du temps, mais je remarque que, depuis, les choses ont commencé a changé là-bas. La dernière fois que ce rituel a eu lieu, c’est à nouveau une fille qui a attrapé la croix! Et cette fois, l’Église l’a autorisée à la conserver. Incroyable, non ? Comme quoi le monde change. Où va-t-on maintenant si l’art peut bel et bien changer le monde, non mais je vous le demande (rires) ?

Il y a plusieurs moments où les personnages regardent directement la caméra : d’abord la journaliste qui s’adresse directement à nous, mais aussi Petrunya de manière plus énigmatique. Que vouliez-vous apporter avec ce procédé?
Petrunya regarde la caméra à deux reprises. Je crois qu’on avait prévu un troisième moment mais on ne l’a pas conservé. Chaque regard devait correspondre à une étape de sa renaissance. A chaque fois, cela signifie qu’elle vient de comprendre quelque chose sur elle-même. Chaque regard lui fait gagner le courage de devenir qui elle est réellement, comme par exemple lorsqu’elle déclare : « Je suis désormais une louve ». C’est comme si elle nous disait « J’ai conscience de qui je suis, et de pourquoi je suis là, mais j’ai aussi conscience de vous qui écoutez mon histoire ». C’est juste un petit truc pour inviter le spectateur à suivre le même chemin d’authenticité que Petrunya. Après les projections, les gens viennent me dire : « Vous savez, Petrunya, c’est moi, c’est nous tous » et c’était un peu ça mon idée.
Vous avez déclaré qu’il vous semblait impossible de naître aujourd’hui et ne pas être féministe…
Je crois que j’ai dit plus exactement qu’il me semblait impossible d’être une femme aujourd’hui et de ne pas être féministe.
Cela veut-il dire que vous avez espoir en la manière dont les questions liées au féminisme sont abordées par les plus jeunes générations ?
Complètement. Hier, quelqu’un m’a fait regarder le clip d’Angèle Balance ton quoi. J’ai adoré. C’est d’autant plus drôle et impressionnant qu’elle est très jeune. Je ne crois pas être naïve en disant que j’ai une grande confiance dans les jeunes, car ils disposent de moyens de communication dont on ignore presque tout quand on est vieux.
L’une des choses que je voulais également montrer dans mon film, c’est qu’à leur manière, les hommes sont eux aussi victimes du patriarcat, ou du machisme si on préfère appeler ça comme ça. C’est notamment le cas chez les garçons encore jeunes. Le plus jeune des policiers déclare d’ailleurs à Petrunya qu’il l’admire et qu’il aimerait posséder son courage. Mon précédent film, When the Day Had No Name, parle de cinq jeunes garçons de Skopje qui réalisent que la société autour d’eux ne leur offre aucune autre issue que de se comporter en machos comme leurs pères. Le patriarcat est une tragédie pour les hommes également.
Mais le monde change vite et dans le bon sens. J’y crois entièrement. Plus d’égalité à l’horizon, entre les hommes et les femmes, entre les pays riches et le tiers-monde… Bientôt le capitalisme va tomber en ruine, et bon débarras. C’est inévitable, sinon on va tous en crever. Quel merde le capitalisme. Mais bon, ça c’est encore un autre sujet (rires).

Votre chef opératrice, Virginie Saint Martin, est française. Quelles décisions esthétiques avez-vous prises avec elle pour traduire en image de récit d’illumination ?
Je viens des beaux-arts ; avant même de faire du cinéma, je faisais de la peinture et de la photographie. Je pense en terme d’images, je fais beaucoup de storyboards et j’accorde énormément d’importances aux décors. Virginie et moi avons envisagé chaque plan de Petrunya comme un tableau. Mais plutôt que de l’envisager sous l’angle des détails et des accessoires, nous nous sommes concentrées sur le ressenti qui naissait de chaque plan. Bien sûr, des choses comme la couleur de telle robe ou tel mur, c’est important, mais Virginie parlions plutôt de l' »odeur » du film : une sensation qui est bel est bien présente mais qu’on a du mal à pointer du doigt. Une autre métaphore que j’emploie souvent c’est celle de la sculpture : un travail collectif, presque physique, pour arriver à traduire l’émotion voulue. Ce que je voulais éviter c’est que le travail sur le cadrage bouffe le reste du film. Quand la forme prend une place disproportionnée, quand on n’arrive pas à s’empêcher de rajouter des effets, on tombe dans le kitsch. Dans mes précédents films, je ne savais pas forcément toujours quand m’arrêter, c’est quelque chose que j’ai appris depuis.
L’actrice principale, Zorica Nusheva, vient du théâtre comique. Qu’est-ce que cela a apporté au film en termes de rythme ?
Tout. Je n’ai plus rien eu à faire. Elle a cette qualité rare qu’ont les très bons acteurs comiques, qui est de comprendre d’instinct le rythme et la construction de chaque scène. C’est elle qui m’a appris des choses, plutôt que l’inverse. Elle est de tous les plans du film, donc elle avait la responsabilité d’avoir toujours en tête l’évolution de son personnage, et de maitriser beaucoup de nuances. Trouver le bon dosage pour chaque scène a été le travail principal. On ne peut pas atteindre ça avec l’improvisation, c’est un travail très minutieux. On a une une tradition théâtrale de qualité dans les Balkans, mais c’est un théâtre de la déclamation. C’est parfois presque surjoué. Quand on travaille avec des comédiens venus de la scène, il faut souvent leur demander d’en faire moins. Je n’en n’ai pas eu besoin avec elle.

Le film est-il sorti en Macédoine du Nord ? Comment a-t-il été reçu ?
Le film est sorti et il est toujours à l’affiche à Skopje. Vous savez on a trois cinémas à Skopje, et dans tout le pays on doit en avoir huit ou dix tout au plus, mais on ne peut même pas vraiment dire que ce sont de vrais cinémas. Du temps de la Yougoslavie, on avait beaucoup plus de salles, on avait une vraie industrie du cinéma, un vrai réseau de distribution, et les gens allaient souvent au cinéma. Tout ça s’est perdu depuis. Les cinémas ne passent plus que des films américains, que les chaines de télévision sont trop pauvres pour pouvoir diffuser à leur tour : elles ne passent donc que des séries B, voire des contrefaçons de films populaires. L’éducation à l’image n’existe plus, il y a toute une génération qui n’est même plus en contact avec le cinéma.
Vous vous rappelez du personnage du policier qui se fait surnommer Brad Pitt ? L’acteur a créé un festival culturel itinérant : dans chaque ville qui accueille ce festival, il installe un cinéma improvisé dans une salle des fêtes, et comme ça, les films sont vus en dehors des cinémas. C’est une affaire qui marche très bien, il y a beaucoup de public. C’est comme ça que notre film a pu être vu en dehors des circuits classiques.
Contrairement à ce qu’on craignait, on n’a eu aucune réaction particulière de l’Église. Les seules réactions violentes sont venues de la part de journalistes, qui m’ont accusée de tourner en ridicule le métier de reporter en Macédoine du Nord. Je leur répondait « Oui tout à fait, et donc ? » (rires). Rien de bien grave. Un film ne peut pas satisfaire tout le monde. L’important c’est que les questions importantes soient posées sur la table, à la vue de tous, une bonne fois pour toute.
Quelle est la dernière fois où vous avez eu le sentiment de voir quelque chose de neuf, de découvrir un nouveau talent ?
Zama de Lucrecia Martel, une cinéaste que j’adore. J’avais un peu peur de ne pas l’aimer autant que ses précédents films, mais j’ai été fascinée par la douceur et la couleur du film. Je suis sortie du film et mes pieds ne touchaient plus le trottoir, j’étais en lévitation.
Entretien réalisé par Gregory Coutaut le 29 avril 2019. Merci à Viviana Andriani.